
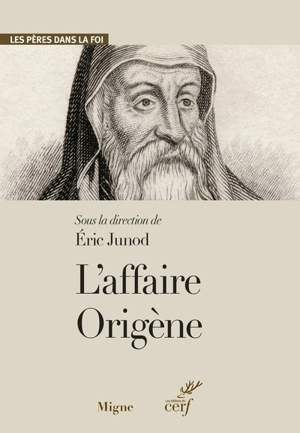
L’affaire Origène, est une polémiques captivantes – qui relève d’une injustice dans l’histoire chrétienne. Ce n’est pas seulement l’histoire d’un théologien, mais celle d’une pensée traquée, malmenée, puis presque effacée. Origène, ce prodige alexandrin du IIIᵉ siècle, a marqué son époque par une intelligence hors norme et une production littéraire colossale. Pourtant, son nom est aujourd’hui surtout associé à une condamnation posthume, scellée par des conciles et des empereurs bien après sa mort. Comment en est-on arrivé là ? C’est ce que nous raconte Junod, professeur d’histoire du christianisme, en compilant et en analysant les textes qui ont forgé cette réputation sombre d’Origène.
Origène fascine autant qu’il divise. Ses commentaires bibliques, son Peri Archôn (un traité audacieux sur les principes de la foi), ou encore son Contre Celse (une défense du christianisme face au philosophe païen) ont influencé des générations de penseurs. Mais certaines de ses idées – comme la préexistence des âmes ou la croyance en une restauration universelle (l’apocatastase) – ont aussi suscité des remous. Dès son vivant, il dut se justifier, puis, après sa disparition, ses écrits furent tantôt encensés, tantôt déformés, jusqu’à devenir la cible de violentes attaques. Junod montre comment une œuvre aussi riche a pu être récupérée, manipulée, puis rejetée par ceux qui, pourtant, en avaient hérité.
Le livre ne se contente pas de retracer une chronologie : il donne à voir les rouages d’une machinerie ecclésiastique où la théologie se mêle à la politique. On y croise Épiphane de Salamine, qui, dans son Panarion, dénonce Origène comme un dangereux innovateur. On y lit les lettres enflammées de Théophile d’Alexandrie, qui, au tournant du Vᵉ siècle, accuse Origène de saper les fondements de la foi. Et puis il y a Jérôme, d’abord admirateur avant de se retourner contre lui, et Rufin, son traducteur en latin, qui tente désespérément de sauver ce qui peut l’être en accusant les ennemis d’Origène d’avoir falsifié ses textes. Une stratégie risquée, que Jérôme ne manquera pas de tourner en dérision : « Si tout ce qui est hérétique chez Origène vient de ses détracteurs, alors il ne reste plus grand-chose de lui ! » (cité p. 210).
Ce qui surprend, à la lecture de ces documents, c’est la manière dont les critiques se radicalisent avec le temps. Au départ, ce sont des désaccords théologiques. Puis, peu à peu, Origène est présenté comme un ennemi de l’Église, un corrupteur de la doctrine. Les moines égyptiens qui s’inspirent de ses idées – les fameuses « origénistes » – sont traqués, leurs monastères dispersés. En 543, l’empereur Justinien va jusqu’à le condamner officiellement, avant que le concile de Constantinople, en 553, ne scelle son sort. Junod souligne un détail glaçant : ces condamnations visent moins Origène lui-même que ceux qui, des siècles plus tard, osent encore le lire et le commenter.
Le plus troublant, peut-être, c’est de réaliser à quel point ces débats révèlent surtout des luttes de pouvoir, des rivalités entre Églises, des stratégies pour contrôler ce qui peut – ou ne peut pas – être pensé. Origène devient un bouc émissaire, un symbole de tout ce que l’orthodoxie naissante cherche à rejeter.
L’un des passages les plus poignants du livre est celui où Junod évoque la disparition des textes grecs d’Origène. Photius, au IXᵉ siècle, est le dernier à avoir lu le Peri Archôn dans sa langue originale. Après lui, plus rien, ou presque. Les manuscrits sont brûlés, oubliés, ou recopiés de manière si partielle qu’il ne nous en reste qu’un quart aujourd’hui. La traduction latine de Rufin, aussi biaisée soit-elle, est devenue notre seule fenêtre sur une pensée qui, autrement, aurait disparu corps et âme.
Éric Junod signe là une enquête rigoureuse, nourrie de sources solides et d’analyses fines. On apprécie particulièrement sa manière de replacer chaque texte dans son contexte, montrant comment les citations sont parfois tronquées, les interprétations orientées. Pourtant, on peut regretter que la défense d’Origène soit si peu audible. Les accusateurs ont droit à de longues citations ; les rares voix qui tentent de le réhabiliter – comme Pamphile, dans son Apologie – ne sont évoquées que brièvement. Dommage, car cela aurait pu équilibrer un récit qui, malgré sa richesse, penche parfois du côté des procureurs.
Autre petit bémol : le style, bien que clair, reste très universitaire. Les néophytes pourraient trouver certains développements ardus, notamment quand il s’agit de controverses trinitaires ou christologiques. Mais c’est le prix à payer pour une étude aussi précise.
Au fond, L’affaire Origène nous parle de bien plus que d’un vieux débat théologique. C’est l’histoire d’un homme dont le crime fut d’avoir trop pensé, trop innové, trop bousculé les certitudes. À une époque où les questions d’orthodoxie et d’hérésie reviennent en force dans les débats religieux, ce livre rappelle une leçon essentielle : condamner un penseur, c’est souvent condamner la pensée elle-même.
Et si, finalement, ce qui dérangeait le plus chez Origène, ce n’était pas ses erreurs, mais son refus des réponses toutes faites ? Le drame d’un HPI au milieu d’hommes de pouvoirs, tout simplement ? Son audace à chercher Dieu au-delà des dogmes, à interpréter les Écritures avec une liberté qui dérangeait ? Junod ne le dit pas explicitement, mais son livre le suggère avec force : les grands esprits ne meurent jamais vraiment. Même condamnés, même effacés, ils continuent de hanter ceux qui, après eux, osent encore penser par eux-mêmes.