
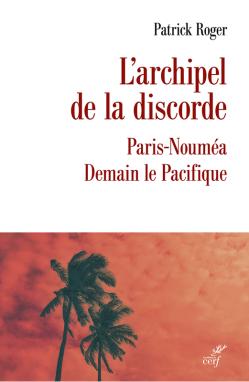
Quand Patrick Roger publie L’archipel de la discorde en 2025, il ne se contente pas de raconter les événements du 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. Il nous plonge dans les entrailles d’un territoire où les vieilles blessures coloniales n’ont jamais vraiment cicatrisé. Ce n’est pas seulement le récit d’une explosion de violence, mais celui d’un échec collectif, d’une société déchirée entre deux visions irréconciliables de son avenir. Avec une précision de chirurgien et la verve d’un journaliste rompu aux conflits politiques, l’auteur, qui avait déjà pressenti le drame dans Nouvelle-Calédonie, la tragédie (2024), décortique ici les mécanismes d’une crise qui a fait voler en éclats des décennies de fragiles équilibres.
Tout part d’une étincelle : la réforme du corps électoral pour les élections provinciales. Une mesure technique, en apparence, qui devient le symbole de toutes les frustrations. Pour les indépendantistes kanak, c’est une trahison, une manœuvre de plus pour diluer leur voix dans les urnes. Pour les loyalistes, c’est une question de justice démocratique. Mais derrière les arguments, ce sont des mémoires blessées qui s’affrontent. Les accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) avaient pourtant dessiné une voie vers la paix. Pourtant, les trois référendums sur l’indépendance (2018-2021), surtout le dernier, boycotté et contesté, ont rouvert les plaies. Quand la CCAT (Cellule de coordination des actions de terrain) brandit la menace d’une mobilisation radicale, quand Sonia Backès, figure des anti-indépendantistes, lance un défi aux séparatistes (« On ne se laissera plus faire », p. 10), le terrain est déjà miné. Et le 13 mai 2024, l’archipel s’embrase.
Ce qui frappe dans ce livre, c’est la manière dont Patrick Roger montre que cette violence n’est pas spontanée. Elle est le fruit d’années de tensions, de discours enflammés, de promesses non tenues. Les barricades de Nouméa, les commerces pillés, les morts dans les affrontements ne sont pas qu’une réaction à une loi. Ils sont le symptôme d’un système à bout de souffle. L’État, accusé d’avoir sous-estimé la crise, envoie des renforts trop tard. Les dirigeants locaux, divisés, incapables de dialoguer, laissent le champ libre aux extrêmes. Christian Tein, figure radicale du FLNKS, incarne cette radicalisation. Son arrestation et son transfert en métropole ne feront qu’en faire un martyr, alimentant encore un peu plus la colère.
L’auteur ne se contente pas de décrire les émeutes. Il en explore les racines, remontant aux inégalités sociales, aux spoliations foncières, à cette sensation, chez une partie de la jeunesse kanak, d’être condamnée à vivre en marge de son propre pays. Les scènes de guérilla urbaine, les églises incendiées, les symboles coutumiers profanés (comme le mausolée du chef Ataï, p. 130) révèlent une société au bord de l’implosion. Même les tentatives de médiation, comme les négociations menées par Manuel Valls en 2025, se heurtent à un mur d’incompréhension. L’accord de Bougival, signé dans l’urgence en juillet 2025, est immédiatement rejeté par les deux camps. Les modérés sont hués, les durs triomphent. « Traîtres ! » hurlent les partisans du FLNKS à Emmanuel Tjibaou (p. 289), tandis que les loyalistes dénoncent un « abandon » de la France.
Si L’archipel de la discorde est un livre puissant, ce n’est pas seulement pour son analyse politique. C’est aussi pour son style, à la fois précis et engagé. Patrick Roger écrit avec la rage de celui qui a vu un rêve s’effondrer. On sent sa frustration face à l’aveuglement des uns et des autres, sa colère contre ceux qui préfèrent l’affrontement à la recherche d’une solution. Peut-être manque-t-il parfois un peu de distance, notamment quand il évoque les jeunes des quartiers populaires, souvent réduits à leur rôle de « casseurs ». Mais c’est aussi ce qui rend son récit si vivant.
Au final, ce livre pose une question glaçante : la Nouvelle-Calédonie peut-elle encore éviter de sombrer ? Entre les calculs politiques, les ego surdimensionnés et les rancœurs historiques, la route vers la réconciliation semble plus longue que jamais. Et le lecteur referme l’ouvrage avec un sentiment de vertige : et si, cette fois, le point de non-retour était franchie ? Une lecture indispensable pour comprendre pourquoi, parfois, l’histoire se répète – dans le sang et les cendres.