
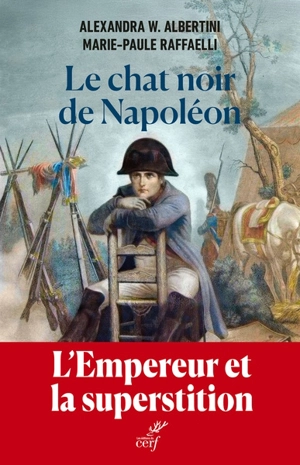
Un Napoléon inédit, entre Lumières et ombres corses Le chat noir de Napoléon n’est ni une biographie classique ni un recueil d’anecdotes fantaisistes. Les autrices, Alexandra W. Albertini (spécialiste de la superstition à l’époque moderne) et Marie-Paule Raffaelli (lauréate du prix Georges Mauguin pour Napoléon et Jésus), proposent une plongée psychologique et littéraire dans les contradictions d’un homme « pétri de religiosité, mais aussi façonné à l’aune des sciences » (p. 12). Leur angle ? Explorer comment le rationalisme proclamé de Napoléon, héritier des Lumières, cohabite avec des croyances superstitieuses enracinées dans son enfance corse et son entourage. Le livre s’appuie sur une relecture minutieuse de ses écrits, de sa correspondance, et des Mémoires de Sainte-Hélène de Las Cases, pour dessiner un portrait « atypique » (p. 20) où se mêlent calcul stratégique et fascination pour l’irrationnel.
Dès les premières pages, le lecteur découvre un Napoléon marqué par deux figures : sa mère, Letizia, « femme au très fort tempérament » (p. 32) et « profondément superstitieuse » (p. 34), et Joséphine, « auréolée de mystère » (p. 48), dont la rencontre est vécue comme un « destin commun et supérieur » (p. 46). Les autrices soulignent comment la Corse du XVIIIe siècle, où « la frontière entre foi chrétienne et croyances superstitieuses était très poreuse » (p. 35), a imprégné le futur Empereur. Letizia, qui « se signait trois fois d’affilée à chaque inquiétude » (p. 34) et redoutait les « trois chandelles allumées » (symbole de veillée funèbre), transmet à son fils une vision du monde où le surnaturel côtoie le quotidien. Napoléon lui-même, bien qu’agnostique revendiqué, conserve des « liens avec le surnaturel » (p. 11) : il évoque sa « bonne étoile », célèbre des anniversaires comme des présages (le 14 juin, date de Marengo et de Friedland), et porte des talismans, comme le « scarabée d’or rapporté d’Égypte » (p. 36).
Cette dualité est au cœur du livre. Les autrices citent ses lettres à Joséphine, où il oscille entre lyrisme amoureux (« Par quel art as-tu su captiver toutes mes facultés ? », p. 47) et rationalisation a posteriori de ses « pressentiments ». Ainsi, après la mort de son commissaire Chauvet en 1796, il écrit : « Je vois son ombre […] son âme est dans les nuages » (p. 52), avant de se traiter lui-même d« insensé » quelques lignes plus bas. Un paradoxe qui illustre sa « pensée magique » (p. 53), concept freudien repris pour analyser son besoin de maîtriser le hasard par des rituels ou des interprétations symboliques.
L’un des grands mérites du livre est de révéler comment ces penchants, loin d’être de simples lubies, ont parfois influencé ses choix. Son sacre en 1804, par exemple, n’était pas qu’un coup de maître politique : c’était aussi une mise en scène savamment orchestrée pour « donner l’illusion d’une légitimité divine » (p. 130). De même, son obsession pour certaines dates ou son goût pour les symboles maçonniques (l’aigle, l’acacia) trahissent une volonté de « domestiquer le destin » (p. 65), de transformer l’incertitude en une série de signes rassurants.
Le chapitre sur la musique et la franc-maçonnerie (p. 95-120) est particulièrement éclairant. Napoléon, mélomane, utilise l’opéra comme « outil de propagande » (p. 98) pour « spiritualiser » son règne, tandis que son rapport ambigu à la maçonnerie – jamais prouvé, mais suggéré par des symboles (l’aigle, l’acacia) – montre comment il « instrumentalise » (p. 105) l’ésotérisme pour renforcer son aura. La relation avec Cambacéres, le concepteur du code civil renforce cette proximité maçonnique dans la construction des acquis pérennes du consulat. Les références à Hiram, architecte mythique du Temple de Salomon, ou à la pyramide d’Égypte, « symbole ascensionnel » (p. 112), soulignent sa quête d’une légitimité quasi divine.
Face à ces élans irrationnels, le livre rappelle constamment le « pragmatisme » (p. 140) de Napoléon. Son Concordat avec le pape en 1801 est présenté comme un « acte utilitaire » (p. 160) pour pacifier la France, et non comme une conversion. De même, son mépris pour les « métaphysiciens » (p. 135) ou sa méfiance envers la médecine (« Je ne prends jamais de remèdes », p. 150) trahissent un esprit cartésien. Les autrices citent Las Cases : « Napoléon ne croit pas aux miracles, mais il croit en sa mission » (p. 170). Cette tension entre foi en son destin et rejet des dogmes religieux donne au livre sa profondeur.`
On émet une réserve sur certaines interprétations qui sorte du travail historique comme la référence à la « cristallisation stendhalienne avec Joséphine (p 46) dans un référentiel psychanalytique en arrière-plan, qui semble très interprétatif. Les nombreux aller et retour entre le passé et un présent historique, fait quitter le cadre chronologique ce qui rend la lecture plutôt érudite.
Le chat noir de Napoléon bénéficie d’une écriture dont l’exigence est remarquable, offrant une « focale intéressante » (p. 25) sur un aspect méconnu de l’Empereur. Les autrices parviennent à montrer que sa superstition n’est ni un mythe ni une vérité absolue, mais un « mélange subtil » (p. 21) qui éclaire sa personnalité et son époque. Leur thèse – « la superstition de Bonaparte est intrinsèquement liée à sa vision autocentrée du monde » (p. 200) – convainc par sa nuance. On referme le livre avec l’envie de relire ses lettres en particulier la correspondance avec Joséphine et bien sûr les incontournables Mémoires de Sainte-Hélène, pour ceux qui cherchent à explorer cette période surprenante de notre histoire qui imprègne encore aujourd’hui notre compréhension historique et socio- psychologique de la France.