
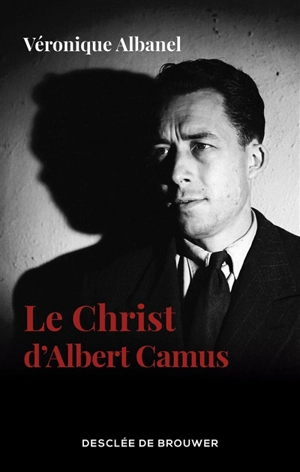
Quand Véronique Albanel publie Le Christ d’Albert Camus en 2025, elle aborde une question qui traverse toute l’œuvre de l’écrivain : comment un homme qui se disait « sans foi, mais pas athée » a pu porter une admiration si profonde pour le Christ tout en rejetant farouchement sa résurrection, sa divinité et la promesse d’une vie éternelle ? À travers une analyse rigoureuse de ses écrits, de ses carnets intimes et de ses entretiens, elle explore ce paradoxe fascinant. Camus vénérait la figure du Christ, mais sans adhérer aux dogmes qui en font un Dieu. Son livre, à la fois érudit et accessible, nous plonge dans l’univers d’un penseur habité par la pensée de la souffrance humaine, la quête de justice et une forme de spiritualité ancrée dans le concret, et un concret social.
Dès les premières pages, une interrogation s’impose : que signifie le Christ une fois dépouillé de la résurrection et de l’espoir d’un au-delà ? On pense évidemment à l’affirmation de saint Paul « Si le Christ n'est pas ressuscité notre foi est vide » (1 Co 15, 14). Pour Camus, la réponse est simple : le Christ incarne avant tout un modèle. Non pas un sauveur céleste, mais un homme dont l’existence, la mort et surtout sa révolte contre l’injustice offrent une leçon de vie inégalée. Comme le souligne Véronique Albanel, ce Christ-là n’est pas celui des Évangiles triomphants, mais celui qui hante les geôles du franquisme, qui se tient aux côtés des déshérités d’Algérie et des exclus de l’Histoire. « Il est un exemple vivant, présent dans les prisons d’Espagne, rendant la terre aux pauvres, se faisant le défenseur des damnés » (p. 12). Bien qu’il ait étudié la Bible et consacré son mémoire de philosophie à la métaphysique chrétienne (son travail universitaire sur saint Augustin ne peut être lu que dans l’édition de la collection de le Pléiade), Camus ne croit pas à la résurrection. Pourtant, il admire profondément la figure du Christ comme symbole d’une humanité à la fois souffrante et généreuse.
L’autrice révèle comment cette fascination trouve ses racines dans les épreuves personnelles de Camus : la tuberculose qui le marque à vie, la misère de son enfance, la trahison de sa première épouse. Face à la douleur, le jeune écrivain découvre dans l’art des primitifs italiens – Piero della Francesca, Giotto – une représentation du Christ qui n’a plus rien du Pantocrator lointain et tout-puissant. Ce Christ-là est un homme de chair, un frère des opprimés comme des oppresseurs. « Le corps seul est généreux », écrit-il (p. 17), et c’est cette incarnation qui le touche au plus profond. Les fresques de la Flagellation et de la Résurrection, contemplées en Toscane, deviennent pour lui des leçons de dignité et de détachement. « Le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n’a pas un regard d’homme. Rien d’heureux n’est peint sur son visage – seulement une grandeur farouche » (p. 59). Pas de miracle ici, pas de victoire sur la mort, mais une solidarité absolue avec les hommes dans leur agonie. « Le christianisme nous a touchés par son Dieu fait homme. Mais sa vérité s’arrête à la Croix » (p. 18).
L’auteure insiste sur l’importance centrale du corps dans la pensée de Camus. Atteint par la maladie, confronté à la fragilité de l’existence, il fait du Christ un « romancier des corps » (p. 14), un témoin de la dignité des êtres de chair, surtout dans leur souffrance. Les visages des paysans espagnols, les mains déchirées des sculptures médiévales, la Mise au tombeau de Giottino : autant d’images qui imprègnent son œuvre. Pour lui, le christianisme a perdu sa force en se détournant de la chair pour se réfugier dans les spéculations sur l’âme. « La chair martyrisée » (p. 20) est le vrai symbole du Christ, bien plus éloquent que les promesses d’immortalité. Dans L’Homme révolté, il affirme : « Seule la souffrance de Dieu, et la plus misérable, pouvait alléger l’agonie des hommes » (p. 19). Mais une fois la divinité niée, cette souffrance redevient le lot exclusif des humains, et Jésus n’est plus qu’« un innocent de plus » (p. 19).
Cette vénération pour le Christ souffrant s’accompagne d’une condamnation sans appel des compromissions de l’Église. Camus fustige le « Christ de plomb » (p. 24) des dévotions superstiteuses, les « hosties de plomb » (p. 25) imposées aux condamnés à mort sous Franco, les bénédictions accordées aux bourreaux. « Si le Christ est quelque part en Espagne, c’est dans les prisons », lance-t-il avec indignation (p. 26), aux côtés de ceux qui refusent la communion forcée par leurs geôliers.
Camus se déclare incroyant, mais son incrédulité n’a rien d’un athéisme militant. « Je ne crois pas en Dieu, c’est exact. Mais je ne suis pas athée pour autant », précise-t-il (p. 28). Son rejet de Dieu est avant tout un refus de l’injustice : « Dieu ne répond pas » (p. 30) à la détresse des hommes. Pourtant, il ne nie pas son existence. « Mon univers secret ? Imaginer un Dieu sans l’immortalité humaine », confie-t-il dans ses Carnets (p. 32). Ce Dieu-là, privé de ses promesses éternelles, pourrait être un Dieu terrestre, partageant la condition humaine sans illusion de salut. Mais l’Église, avec son dogme de l’immortalité de l’âme, a trahi ce message. « La croyance en l’immortalité a permis au christianisme de justifier la peine capitale », écrit-il dans Réflexions sur la guillotine (p. 42).
Son rejet vise aussi un christianisme complice des puissants. Dans La Chute, il raille les « pharisiens laïques » qui jugent autrui tout en se croyant sauvés. « La justice et l’innocence sont désormais séparées : l’une sur la croix, l’autre reléguée au placard » (p. 53), résume-t-il avec amertume. Malgré tout, il garde une tendresse pour les vrais chrétiens, comme son ami résistant René Leynaud, fusillé par les nazis. « En trente ans, aucune mort ne m’a autant bouleversé » (p. 22).
Si Camus rejette la grâce divine, il ne renonce pas pour autant à la morale. Bien au contraire, il en fait le cœur de sa réflexion. « Il faut trancher : ou le Christ, ou le tueur » (p. 71), déclare-t-il. Ce choix, c’est celui du refus absolu du meurtre, de la solidarité avec les humiliés, de la lucidité face à l’absurde. Sa morale ne repose pas sur des principes abstraits, mais sur l’expérience concrète de la souffrance. « Les masses laborieuses, épuisées par la souffrance et la mort, sont des masses sans Dieu. Notre place est à leurs côtés » (p. 38).
Dans L’Homme révolté, il élabore une éthique de la mesure, où la révolte doit rester fidèle à la vie sans sombrer dans le nihilisme ou la violence. « La révolte ne peut exister sans amour » (p. 169), écrit-il. Cet amour n’est pas une charité chrétienne, mais une « disponibilité divine » (p. 167) – une ouverture inconditionnelle aux autres, un refus catégorique de l’indifférence. « Nous nous sommes toujours entraidés pour vivre, avec cette complicité merveilleuse de ceux qui luttent et souffrent ensemble. Voila ce qu’est l’amour – l’amour pour tous » (p. 170).
Albanel explore avec finesse la dimension mystique de Camus, marqué par Plotin et les mystiques silésiens. « La chair devient consciente et consacre sa communion avec un mystère sacré », note-t-il dans Noces (p. 113). Mais cette mystique n’est pas une échappatoire. « Dans les tranchées, sous les obus, l’éternel perd de son éclat » (p. 115). Pour Camus, l’extase doit se vivre dans l’action, non dans la contemplation solitaire.
Son Christ est un « militant farouche » (p. 59), proche du « Christ-Pan » (p. 118) – une figure à la fois païenne et chrétienne, un dieu de la nature et des hommes. « Mon royaume est en ce monde » (p. 156), pourrait-il dire. Même dans Le Premier Homme, où il assimile sa mère illettrée au Christ (« Sa mère est le Christ », p. 57), c’est la dignité des humbles qu’il célèbre, non une transcendance lointaine.
Le Christ d’Albert Camus est un livre précieux pour comprendre comment un incroyant a pu faire du Christ une figure centrale de sa pensée. Albanel manie avec habileté les citations, les références biographiques et les analyses textuelles. On salue particulièrement son refus de « christianiser » Camus, tout en montrant la profondeur de son dialogue avec le christianisme.
Cependant, l’ouvrage pèche parfois par répétition. Les thèmes de la souffrance, de la révolte et du rejet de l’immortalité reviennent en boucle, comme si l’autrice craignait que le lecteur n’en saisisse pas toute la portée. Certains développements sur la mystique ou la grâce auraient gagné en concision.
À une époque où les débats sur la laïcité, la justice sociale et le sens de l’engagement resurgissent avec force, la lecture de Camus par Albanel est plus que jamais pertinente. « Dans un monde rongé par la haine, il a choisi d’être simplement un homme » (p. 171). Son Christ n’est ni un sauveur ni un prophète, mais un compagnon de route, un témoin de la beauté et de l’injustice du monde. « Il nous a appris qu’on peut avoir raison et être vaincu, que la force peut briser les âmes, et que le courage ne garantit pas la victoire » (p. 180).
On peut simplement s’interroger, dans sa pensée, sur l’absence de relation entre la misère de l’homme en croix et la nécessité de la résurrection qui habite les chrétiens depuis l’origine.
Camus reste un phare pour ceux qui, sans illusion métaphysique, refusent de désespérer. « Continuer à vivre et à aimer, même dans la défaite » (p. 180) : tel est peut-être l’héritage le plus précieux de ce « Christ sans résurrection », mais profondément vivant.