
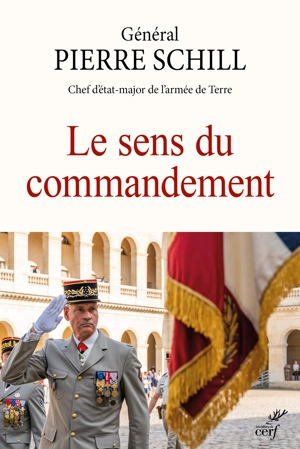
Quand on ouvre Le sens du commandement, le dernier essai du général Pierre Schill, on comprend rapidement qu’il ne s’agit pas d’un simple manuel de stratégie militaire, mais d’une réflexion profonde sur ce que signifie vraiment diriger, inspirer et responsabiliser – que ce soit sur un champ de bataille ou dans la vie civile. Publié en octobre 2025 aux éditions du Cerf, ce livre arrive à point nommé, alors que la question du leadership, de l’autonomie et de la confiance refait surface dans tous les secteurs de la société.
Dès les premières pages, Schill pose une question qui résonne comme un leitmotiv : « De quoi s’agit-il ? » Une interrogation héritée du maréchal Foch, qui invite chaque chef, chaque décideur, à clarifier non seulement ses ordres, mais surtout l’intention qui les sous-tend. Pour l’auteur, ancien chef d’état-major de l’armée de Terre, le vrai commandement ne se résume pas à une liste d’instructions détaillées. Il repose sur une idée simple, mais révolutionnaire : définir une direction claire, un objectif précis – ce qu’il appelle « l’effet majeur » – puis faire confiance à ceux qui doivent le concrétiser. « Le commandement est une condition essentielle de la réussite, écrit-il. Miser sur des principes qui encouragent l’autonomie, la prise de responsabilité et l’initiative compte autant, sinon plus, que de disposer des meilleurs équipements ou d’une organisation irréprochable » (p. 14).
Ce qui frappe dans cet ouvrage, c’est la manière dont Schill revisite une tradition bien française : le « commandement par intention ». Plutôt que d’imposer des méthodes rigides, le leader doit énoncer une finalité, un but à atteindre, et laisser ses équipes choisir les moyens pour y parvenir. Une approche qui puise ses racines dans l’histoire militaire, des victoires napoléoniennes aux succès de la Libération, où la capacité à s’adapter et à innover a souvent fait la différence. « Le plan, rappelle-t-il, est la première victime de la guerre » (p. 12). Face à l’imprévisible, c’est la compréhension profonde de la mission qui permet de garder le cap, même quand tout semble s’effondrer.
Mais au-delà des exemples historiques, Schill s’attaque à un problème bien contemporain : la tentation de tout contrôler, de tout normaliser, au risque d’étouffer l’initiative et la créativité. Il dénonce avec fermeté la bureaucratie qui gangrène les institutions, militaires comme civiles, et qui transforme les individus en simples exécutants, privés de toute marge de manœuvre. « L’armée de Terre est le reflet de la société, explique-t-il. Elle ne peut ignorer les mutations qui la traversent » (p. 14). Dans un monde où la jeunesse exige du sens et où les conflits modernes demandent agilité et réactivité, un commandement trop rigide devient un handicap. « La guerre est de retour en Europe, souligne-t-il. Les armées pourraient être engagées dans des affrontements où l’échec ou la victoire prendront une tout autre dimension qu’auparavant. » Dans ce contexte, la confiance et la subsidiarité ne sont plus des options, mais des nécessités.
L’un des grands mérites du livre est de ne pas rester dans l’abstraction. Schill propose une méthode concrète, fondée sur le dialogue, la transparence et une hiérarchie alignée sur un objectif commun. « Commander et obéir » devient un exercice d’équilibre, où chaque maillon de la chaîne – du général au soldat – doit comprendre non seulement « quoi faire », mais « pourquoi le faire ». Cette vision rejoint d’ailleurs les analyses d’intellectuels comme David Graeber, cité en postface par Gaspard Koenig, pour qui la suradministration et la défiance systématique asphyxient toute forme d’initiative. « Plus une règle est simple, plus elle est contraignante, car elle ne laisse place à aucune ambiguïté », résume Koenig, soulignant que la vraie discipline naît de la responsabilité, et non de la contrainte.
Pourtant, si la théorie est séduisante, sa mise en pratique soulève des défis de taille. Schill lui-même admet que le « commandement par intention » se heurte souvent à des résistances, notamment dans la gestion quotidienne des armées, où les habitudes de centralisation et de micro-management ont la vie dure. « Croire que les troupes sauront soudainement s’adapter le jour J, sans avoir été préparées en amont, relève de l’illusion » (p. 14). On aurait aimé que l’auteur développe davantage d’exemples concrets de réussites – ou d’obstacles – rencontrés sur le terrain. Comment, par exemple, concilier cette philosophie avec les lourdes contraintes logistiques et administratives d’une institution comme l’armée de Terre ? La question reste en partie ouverte.
Ce qui rend ce livre particulièrement intéressant, c’est qu’il dépasse largement le cadre militaire. Schill s’adresse en réalité à tous ceux qui, dans une entreprise, une administration ou une association, sont confrontés à la complexité du leadership. « Au-delà du champ opérationnel, il propose une approche universelle, applicable à toute organisation humaine », note le ministère des Armées. En cela, Le sens du commandement devient une lecture utile pour quiconque doit fédérer une équipe, prendre des décisions dans l’incertitude ou simplement donner du sens à son action. « Commander, c’est avant tout donner du sens », résume Schill (p. 14), une phrase qui pourrait servir de devise à bien des managers.
Bien sûr, certains pourront trouver que l’ouvrage manque parfois de précisions sur la façon de mettre en œuvre ces principes au quotidien. Mais sa force réside ailleurs : dans son appel à une « transformation des mentalités », dans sa défense d’un leadership à la fois exigeant et humain, où la confiance prime sur la méfiance, et où l’intelligence collective l’emporte sur les procédures. « Renouer avec l’esprit d’un commandement à la française, valable aussi bien pour le combat que pour la vie courante, est un défi urgent », écrit-il (p. 142).
En définitive, Le sens du commandement est bien plus qu’un essai sur la stratégie militaire. C’est une réflexion sur la liberté, la responsabilité et l’art de diriger dans un monde en pleine mutation. À une époque où la défiance et l’individualisme gagnent du terrain, Schill nous rappelle une évidence trop souvent oubliée : « Le vrai pouvoir ne consiste pas à tout contrôler, mais à savoir faire confiance. » Une leçon qui, si elle était mieux comprise, pourrait changer bien des choses – dans l’armée comme ailleurs.