
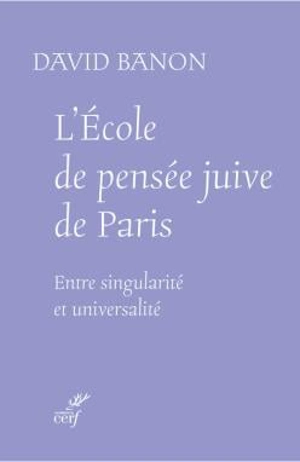
Plonger dans L’École de pensée juive de Paris de David Banon, c’est découvrir un pan méconnu mais fascinant de l’histoire intellectuelle française. Ce livre, bien plus qu’un simple essai historique, nous entraîne dans le sillage d’un mouvement de pensée audacieux, né après la Seconde Guerre mondiale, et porté par des figures aussi marquantes qu’Emmanuel Levinas, André Neher, Léon Askenazi ou Éliane Amado Lévy-Valensi. À travers une édition revue et enrichie, Banon nous révèle comment ces intellectuels ont su redonner vie à la tradition juive, non pas comme un héritage figé, mais comme une source d’inspiration pour repenser le monde moderne.
L’auteur commence par situer ce courant, que Levinas et Wladimir Rabi qualifiaient avec une pointe d’ironie d’« École de Paris », en référence à l’effervescence artistique des années 1920, mais transposée ici dans le domaine de la pensée juive. Ce qui frappe, c’est la manière dont ces intellectuels ont su concilier leur singularité juive avec une ambition universelle. Contrairement à la Wissenschaft des Judentums allemande, qui cherchait à adapter le judaïsme aux normes académiques, ces penseurs ont assumé leur identité sans concession, en s’appuyant sur les textes rabbiniques pour dialoguer avec la philosophie occidentale.
Dès les premières pages, Banon pose une question essentielle : comment des hommes et des femmes marqués par la Shoah et l’exclusion ont-ils pu transformer leur héritage en une pensée vivante, capable d’enrichir la culture moderne ? La réponse réside dans leur rapport aux textes. Pour eux, la Bible et le Talmud ne sont pas des reliques du passé, mais des sources inépuisables pour repenser l’éthique, l’histoire et la révélation.
Banon consacre des développements substantiels aux grandes figures de ce mouvement. On y découvre Jacob Gordin, le précurseur, qui a insufflé un esprit nouveau à l’École d’Orsay en mêlant rigueur intellectuelle et sensibilité juive. Puis viennent les « quatre piliers » : André Neher, qui a redonné vie au texte biblique en le lisant « sous le signe de Moïse plutôt que sous celui de Wellhausen » ; Léon Askenazi (surnommé Manitou), éducateur charismatique qui a formé des générations de Juifs français à une lecture renouvelée du midrach et de la kabbale ; Éliane Amado Lévy-Valensi, dont l’approche féminine et psychanalytique a éclairé des aspects inédits des récits bibliques ; et enfin Emmanuel Levinas, dont la philosophie de l’altérité a introduit des concepts juifs comme hinéni (« me voici ») ou la responsabilité envers autrui dans le débat philosophique contemporain.
L’un des passages les plus poignants du livre est celui qui traite de l’impact de la Shoah sur ces penseurs. Banon montre comment cette tragédie a forcé ces intellectuels à repenser leur judéité non comme un simple héritage, mais comme une identité à reconstruire activement. Levinas, dont la famille a été décimée, écrit que leur mission était de « donner un sens à leur statut de survivant » (p. 25). Cette quête a donné naissance à une pensée où la révélation n’est plus une épiphanie mystique, mais un appel éthique à la responsabilité envers autrui.
Ce qui rend ce livre particulièrement captivant, c’est la manière dont Banon met en lumière la méthode de ces penseurs. Leur outil principal ? Le midrach, cette lecture juive qui ne se contente pas d’interpréter les textes, mais les fait parler, les réactualise. Comme le souligne Banon, « le midrach ne parle pas des textes, il fait parler les textes » (p. 36). Cette approche permet de dépasser les oppositions entre tradition et modernité, en montrant que les questions contemporaines – la violence, la fraternité, la justice – trouvent un écho dans les récits bibliques.
Un exemple est l’analyse du chapitre 4 de la Genèse (Caïn et Abel) par les quatre penseurs. Chacun y puise des enseignements différents : Neher y voit l’origine de la violence dans l’histoire, Amado Lévy-Valensi y explore l’échec du dialogue, Manitou l’impossibilité de la fraternité sans réciprocité, et Levinas, enfin, en tire une méditation sur la responsabilité envers autrui. Ces lectures croisées illustrent comment le midrach permet de « défaire le silence du texte pour saisir le bruissement de son oralité » (p. 37), selon la formule inspirée de Banon.
L’ouvrage n’élude pas les tensions internes de cette école. Banon aborde les divergences sur la question de l’histoire : certains, comme Neher, voient dans le messianisme juif une force motrice de l’histoire, tandis que d’autres, comme Levinas, préfèrent une position en surplomb, où le peuple juif incarne une « autre histoire », celle de la révélation. Ces débats reflètent une question plus large : comment concilier l’engagement dans le monde et la fidélité à une tradition qui transcende l’histoire ?
Banon évoque la postérité de cette école. Il montre comment des figures comme Henri Atlan, Stéphane Mosès ou Catherine Chalier ont prolongé cette pensée, tout en l’adaptant à de nouveaux enjeux. L’auteur cite également ce qu’il appelle les outsiders de cette école. Parmi ceux-ci jacques Derrida, qui malgré les critiques et les interrogations sur la religion, n’a jamais renié sa judéité. Quel que soit la position l’auteur note les risques d’une appartenance en tension entre un repli identitaire ou une dilution dans le discours universel, deux écueils que l’École de Paris avait su éviter.
Le grand mérite de cet ouvrage est de rendre accessible une tradition complexe. Banon écrit avec une clarté qui rend son sujet passionnant, même pour un lecteur non spécialiste. Son style, à la fois précis et poétique, fait écho à la pensée des maîtres qu’il étudie. On apprécie particulièrement sa capacité à lier les concepts philosophiques à des récits concrets, comme celui de la rencontre entre Manitou et le Rav Tsvi Yéhouda Kook, qui a marqué un tournant vers le sionisme pour une partie de l’école.
Cependant, l’ouvrage peut parfois sembler dense pour qui n’est pas familier avec les textes rabbiniques ou la philosophie juive. Banon suppose une certaine connaissance préalable, ce qui peut rendre la lecture ardue par moments. Une introduction plus pédagogique aurait pu aider à situer les enjeux pour un public plus large.
Par ailleurs, si Banon célèbre à juste titre l’audace de ces penseurs, on peut regretter qu’il n’approfondisse pas davantage les critiques qui leur ont été adressées. Par exemple, la tension entre universalisme et particularisme, centrale dans leur pensée, mérite d’être plus longuement discutée, notamment à la lumière des débats contemporains sur l’identité et la laïcité.
L’actualité de cette école est remarquable. À une époque où les questions d’identité, de mémoire et de dialogue entre les cultures sont plus brûlantes que jamais, la pensée de Levinas, Neher ou Amado Lévy-Valensi offre des pistes précieuses. Leur refus de dissocier singularité et universalité, leur insistance sur la responsabilité envers autrui, leur manière de faire dialoguer les textes anciens avec les défis modernes résonnent avec les interrogations d’aujourd’hui.
Banon conclut en soulignant que l’esprit de l’École de Paris « féconde encore les œuvres de ceux qui pensent, enseignent et écrivent » (p. 400). C’est peut-être là le plus bel hommage qu’on puisse lui rendre : cette pensée n’est pas un vestige du passé, mais une source vive pour ceux qui, aujourd’hui, cherchent à concilier fidélité et ouverture, tradition et innovation.
En définitive, L’École de pensée juive de Paris est bien plus qu’un livre d’histoire : c’est une invitation à redécouvrir une tradition qui, loin de se replier sur elle-même, a su transformer son héritage en une parole vivante, capable d’éclairer notre présent. Une lecture indispensable pour quiconque s’intéresse à la philosophie, au judaïsme ou, plus simplement, à la manière dont une pensée peut renaître des cendres de l’histoire.