.jpeg)
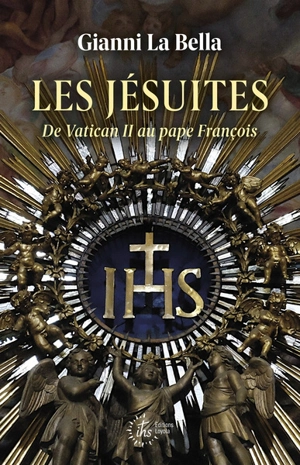
On ne peut comprendre l’histoire de l’Église depuis le XVIe siècle sans connaître celle de la Compagnie de Jésus. Les Jésuites sont, on le sait, la congrégation religieuse masculine la plus nombreuse. Leur fameux quatrième vœu (d’obéissance au Pape) en a fait un instrument majeur de la politique d’évangélisation de Rome. Depuis le milieu du XXe siècle, la Compagnie a connu une réforme radicale et traversé des tempêtes, sans perdre pourtant son dynamisme ni sa fidélité à l’esprit de son fondateur. C’est cette histoire que rapporte le livre de Gianni La Bella, Les Jésuites de Vatican II au pape François. L’auteur est Professeur d’histoire contemporaine de l’Église à l’Université de Modène. Il a beaucoup publié sur les Jésuites et sur l’Église d’Amérique Latine.
Deux éléments frappent surtout dans l’histoire récente de la Compagnie telle que la rapporte G. La Bella : d’une part le déclin démographique de la Société de Jésus - phénomène commun alors à tous les grands ordres religieux de l’Église, mais particulièrement accentué en l’occurrence (36 000 jésuites en 1965, environ 15 000 aujourd’hui) -, accompagné d’un fort déplacement du centre de gravité de la Compagnie vers l’Asie (2700 jésuites en Inde en 1965, environ 5000 en 2025); d’autre part la véritable refondation de la Compagnie dans le temps postconciliaire (l’auteur parle même d’une « troisième Compagnie », après celle d’Ignace, puis celle qui est réapparue en 1814 après la suppression de 1773).
Le plan du livre est chronologique, même si de nombreux retours en arrière ou projections dans le futur en brouillent parfois la lecture. L’ouvrage offre avant tout un récit de l’action des Généraux, tous élus à vie en principe, mais dont aucun, dans cette période, n’a été jusqu’au bout de son mandat. L’on découvre successivement les généralats du Père Pedro Arrupe (1965-1981), puis - après l’intermède de la direction de la Compagnie par un délégué du Pape (le P. Dezza, jésuite, futur cardinal) - de Peter Hans Kolvenbach (1983-2008), d’Adolfo Nicolas (2008-2016) et enfin d’Arturo Sosa, actuel général depuis 2016, premier général non européen, vénézuélien, donc latino-américain comme le pape François, premier pape jésuite et premier pape non européen depuis l’Antiquité.
La personnalité la plus forte de toute cette période est certainement Pedro Arrupe. Longtemps missionnaire au Japon et très profondément préparé par cette expérience à la fois au sens de la mission et à l’ouverture à la pluralité des cultures et des spiritualités, ce Basque élu en 1965 par la XXXIe congrégation générale à la tête de la Compagnie va lui faire accomplir une véritable révolution (révolution au sens strict, car elle ramène au point de départ : l’intuition et la spiritualité d’Ignace de Loyola), la détournant d’une pastorale trop tournée vers les milieux puissants, riches et influents pour donner une véritable priorité aux pauvres, jusqu’à vivre comme eux et parmi eux. Il ne veut pas séparer Foi et Justice. Ce choix sera définitif pour la Compagnie.
Le livre montre à quel point le mandat d’Arrupe a été une période de bouillonnement, de tempêtes et de renouveau profond, très caractéristique de la période postconciliaire. Il retrace la fameuse crise d’Amérique latine : beaucoup de jésuites y entrèrent en résistance contre les inégalités sociales et les différentes formes d’oppression. Cet engagement, en lien avec le développement de la Théologie de la Libération, alla parfois de pair avec des prises de position politiques. Le rapport supposé entre certaines vues théologiques et le marxisme entraîna de violentes polémiques (Arrupe fera du reste une mise au point importante sur les limites de la théorie marxiste). Au-delà même de l’Amérique latine, tout un camp rejetait au second plan la vie spirituelle et l’apostolat intellectuel, force traditionnelle de la Compagnie. La formation fut revue d’une façon qui privilégiait les sciences humaines, ce qui souleva l’inquiétude d’un autre camp. Pour quelques-uns, l’obéissance n’allait plus de soi. La Compagnie se divisa profondément. Il se créa même un groupe sécessionniste en réaction contre les évolutions « progressistes » : il se prétendit la « vraie Compagnie » et obtint en 1969 le soutien des évêques d’Espagne. Tout ce tourbillon inquiétait les Papes, qui multiplièrent les interventions et les mises en garde.
Au sein de cette tempête, Arrupe s’est efforcé de conserver l’unité des siens, de dialoguer avec le Vatican dans une grande fidélité à l’Église et au pape, de promouvoir l’internationalisation de la Compagnie, l’inculturation, l’écologie, l’apostolat social, et, en même temps, de rappeler la nécessité de l’humilité, d’une vie spirituelle profonde, de la pratique des Exercices Spirituels ignaciens. Il réunit une congrégation générale, la XXXIIe, en 1974-75. Il fut élu président de l’Union des Supérieurs généraux. Son activité débordante, au sein de tensions très lourdes, explique sans doute en partie l’hémorragie cérébrale qui le frappa en 1981. La fin de sa vie, jusqu’à sa mort en 1991, fut un temps d’immobilité physique et de dépendance, d’incapacité de parler. Gianni La Bella n’hésite pas à la définir comme une « identification mystérieuse à la kénose du Christ » (p. 203).
La crise de la Société de Jésus est alors si profonde que Jean-Paul II - lui-même victime d’un attentat en 1981- n’autorise pas la convocation d’une congrégation générale pour désigner un successeur au P. Arrupe, mais désigne un Délégué qui va diriger provisoirement la Compagnie. Cette décision est un séisme pour les Jésuites, un cas unique dans leur histoire, vécue avec beaucoup d’amertume. Heureusement, selon G. La Bella, le délégué désigné, le jésuite Dezza, est un modéré, qui agit avec prudence et habileté diplomatique et obtient en définitive assez rapidement l’autorisation de convoquer la congrégation générale.
Celle-ci, réunie en septembre 1983, élit comme nouveau Préposé Général le Père néerlandais Peter Hans Kolvenbach, missionnaire au Liban. Très ouvert au dialogue œcuménique, spécialement avec les Églises orientales, et au dialogue interreligieux, notamment avec les musulmans, professeur de linguistique générale à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, il a été le très courageux provincial jésuite du Proche-Orient au moment de la guerre civile du Liban. On lui reconnaît un grand sens de l’écoute. Moins charismatique que le P. Arrupe, moins prophétique, il continue la ligne de son prédécesseur en un style différent. Selon G. La Bella, le P. Kolvenbach va parvenir à apaiser les relations entre les courants opposés au sein de la Compagnie. Il invite les Jésuites à embrasser « avec plus d’enthousiasme les nouvelles tâches confiées par Jean-Paul II comme l’œcuménisme, l’approfondissement des rapports avec les religions non chrétiennes, le dialogue avec les cultures » (p. 216). Très attaché à la spiritualité d’Ignace, qu’il définit comme une mystique du « pèlerin », il fait de la pratique des Exercices Spirituels le point de départ du renouvellement de la compagnie. Par ailleurs, après l’Amérique latine dans les années 70, l’Asie (avec, dans cette période, la remarquable progression de la Compagnie en Inde, le développement d’une théologie « indo-asiatique », le souci de la pénétration en Chine) et l’Europe de l’Est (avec la création de la délégation Pro Rebus Russicis) deviennent avec lui des priorités des Jésuites. Kolvenbach donne aussi une vigueur renouvelée à l’engagement des Jésuites auprès des immigrés et des réfugiés, en particulier au moyen du Service jésuite pour les Réfugiés. Dans un autre domaine, il s’intéresse au processus d’édification de l’Union européenne. Il faut noter enfin sa volonté forte de travailler avec les laïcs.
En 1995, Kolvenbach réunit une Congrégation générale, la XXXIVe. Elle réforme le gouvernement de la Compagnie et adopte vingt-six décrets, surtout remarquables par leur volonté de mettre fin aux « exagérations du passé » et de balayer l’ensemble des apostolats jésuites (y compris l’écologie), en préférant les propositions concrètes aux théories.
Le livre examine ensuite en trois pages très rapides (p. 311-313) les années 1995 à 2005. En 2006, P. H Kolvenbach, très fatigué (il s’éteindra en 2016), obtient du pape Benoît XVI la permission de démissionner. Or la Compagnie suscite toujours en ce début du XXIe siècle la méfiance d’une partie de la Curie. Plusieurs théologiens jésuites ont été condamnés entre 2001 et 2007. L’hypothèse d’une nouvelle nomination d’un délégué est envisagée. Le candidat de la Curie pour ce poste n’aurait été autre qu’un certain Jorge Bergoglio ! Mais celui-ci, tout comme Kolvenbach, s’oppose fortement à cette idée, et elle est abandonnée.
La XXXVe Congrégation générale se tient donc à Rome à partir de janvier 2008. Le P. Adolfo Nicolas, Espagnol de 72 ans, provincial du Japon, très bon connaisseur des religions d’Extrême-Orient, est élu Général. Dans la suite de ses travaux, la Congrégation définit cinq domaines privilégiés pour la mission jésuite : l’Afrique (c’est une nouveauté), la Chine, l’apostolat intellectuel (point cher au Général, alors qu’une partie de la compagnie le négligeait), les institutions interprovinciales à Rome et le service des réfugiés. Un décret insistera aussi sur la nécessité de donner vitalité à la vie communautaire, contre la forte tentation individualiste, une préoccupation récurrente dans toute cette période. Enfin, avec un rapport dédié, « l ‘écologie devient un thème dominant dans tous les aspects de la vie de la Compagnie » (p. 337).
A. Nicolas restera très peu de temps à la tête de la Compagnie. Dès 2014, il annonce sa volonté de se démettre et convoque la XXXVIe Congrégation générale. Celle-ci se réunit en octobre 2016. Elle va élire le premier Général non européen de l’histoire de la Compagnie : le Vénézuélien Arturo Sosa, né en 1948, ancien recteur d’université et ancien provincial, assistant du P. Nicolas dès 2008, puis responsable des maisons interprovinciales de Rome. Nicolas mourra en 2020.
Un dernier chapitre du livre dans sa version française étudie très rapidement l’évolution de la Compagnie jusqu’en 2023. Il n’existe pas dans l’édition originale italienne. Qui l’a écrit ? L’auteur (sans doute) ? Le traducteur ? Il ne permet pas de percevoir vraiment la marque propre du généralat de Sousa.
À vrai dire, le plus important c’est, depuis 2013, l’élection du premier pape jésuite. Même s’il ne s’y risque pas directement - ce n’est d’ailleurs pas son sujet -, c’est l’un des intérêts du livre que d’éclairer involontairement la figure du pape François. Si l’on prend plusieurs des points qui, dans l’esprit des fidèles, constituent l’originalité de son pontificat, l’on s’aperçoit qu’ils s’expliquent souvent moins par des traits particuliers de sa pensée et de sa spiritualité que par son appartenance à la Compagnie de Jésus. François était un jésuite et l’a clairement assumé. Même le trait qui a le plus frappé l’opinion, la promotion de l’écologie (« intégrale »), notamment dans Laudato Si’, provient moins d’une influence franciscaine que des engagements résolus de la Compagnie sur ce thème, au moins depuis Arrupe. Quant à l’autre aspect du pontificat qui a le plus marqué, l’engagement en faveur des immigrés et des réfugiés, s’il est traditionnel dans l’Église et chez les papes qui l‘ont précédé, il a pris avec François un caractère radical et surtout concret, pratique, qui là aussi doit tout à l’expérience jésuite : qu’on pense à l’admirable Service Jésuite pour les Réfugiés. Inutile de souligner comment, dans le même sens, la priorité donnée aux pauvres est une obsession des Généraux jésuites successifs. Le mode de gouvernance avec le fameux C 9, l’insistance sur le discernement, la défense de la religion populaire, la dévotion au Sacré-Cœur, ou même, d’une façon plus anecdotique, les mises en garde contre les commérages, tout cela est d’inspiration jésuite.
Il est d’ailleurs amusant de voir qu’alors que François laisse dans l’opinion l’image d’un pape réformateur, voire « progressiste », il ne passait pas pour spécialement « progressiste » dans la Compagnie au moment de son élection. Au contraire, selon G. La Bella, beaucoup de ses frères, dans un premier temps, ne se sont pas réjouis de son élection, le jugeant trop « traditionnaliste » (p. 348).
Le livre s’achève donc sur la période du pontificat de François. Curieusement, s’agissant de l’ouvrage d’un universitaire, il ressemble plus, volontairement, sans doute, à une enquête journalistique qu’à un livre d’histoire scientifique. G. La Bella est remarquablement informé, a eu accès aux archives de la Compagnie, a manifestement une connaissance directe de plusieurs acteurs de son récit, mais un certain laxisme par rapport aux règles académiques, des jugements de valeur qui ne cachent guère les sentiments personnels de l’auteur, des passages qui frôlent l’hagiographie, tout cela nous écarte du style universitaire. Cependant peut-être les lecteurs préfèreront-ils cette vivacité à l’austérité scientifique !
L’ouvrage reste passionnant, et il aide beaucoup à comprendre et à aimer la Compagnie. Certes les membres de la famille dominicaine sentiront nettement les différences organiques entre Jésuites et Dominicains, dans leur mode de gouvernance, par exemple, dans la place qu’occupe la prière liturgique, dans la nature de leur vie communautaire, dans l’existence ou non de branches monastique et laïque de l’Ordre, dans leur spiritualité, etc., mais l’on ne peut oublier que les deux Ordres se rapprochent fortement par l’importance pour chacun d’eux de l’intelligence de la Foi et par leur unique finalité : l’apostolat.
Comment ne pas admirer, à travers ses grandeurs et ses faiblesses, la générosité de l’engagement de la Compagnie au service de Dieu, de l’Église et des hommes ? Cette générosité, beaucoup de ses membres l’ont poussée en ce temps jusqu’au don suprême de soi : le martyre. Martyrs d’Albanie, de Syrie, du Liban, du Sud-Soudan, du Rwanda, du Mozambique, du Zimbabwe, du Mexique, du Salvador, du Brésil, du Venezuela…, tous assassinés en raison de leur engagement chrétien. Et martyre, en un sens plus particulier, de Pedro Arrupe, figure de sainteté, dont la cause de béatification a été introduite à Rome en 2019.