
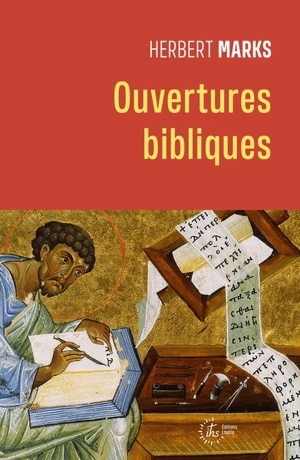
Ouvertures bibliques, signé Herbert Marks et traduit en français par Claude Grimal, se présente comme une exploration audacieuse de l’Ancien Testament, livre après livre. Plutôt qu’un simple commentaire, cet essai propose des clés pour pénétrer un texte à la fois sacré et profondément humain, souvent perçu comme énigmatique ou rigide. L’auteur, fin connaisseur de la littérature biblique, y mêle habilement analyse littéraire, perspective historique et esprit critique, invitant chacun à redécouvrir la profondeur et la complexité de ces écrits fondateurs.
Le livre s’articule autour des quatre grandes divisions de la Bible hébraïque : les récits historiques, le Pentateuque, les écrits poétiques et sapientiaux, et les prophètes. Chaque partie s’ouvre sur une introduction théorique, suivie d’une étude minutieuse de chaque livre. Marks y défend une idée forte : la Bible n’est pas un bloc monolithique, mais une mosaïque de récits, de styles et de voix, façonnée par des siècles de réécritures et d’interprétations. Dès les premières pages, il rappelle que ces textes, bien que familiers, « ne cessent de nous surprendre » (p. 7), tant par leurs contradictions que par leur capacité à résonner à travers les âges.
Dans la section dédiée au Pentateuque, Marks décrypte la Genèse comme une introduction mythique et généalogique, où se croisent le quotidien et l’extraordinaire, l’élection d’Israël et une étrange empathie pour ceux qui en sont exclus. L’Exode, cœur battant de la Bible hébraïque, y est présenté comme le récit d’une libération qui se double d’une révélation. Le Lévitique, souvent délaissé, est réhabilité en tant que « manuel des prêtres », définissant la notion même de sacré. Quant aux Nombres et au Deutéronome, ils apparaissent comme des textes charnières, où se mêlent lois, récits et prophéties, reflétant les débats idéologiques qui ont traversé l’histoire d’Israël.
Les livres historiques (Josué, Juges, Samuel, Rois, Chroniques, Esdras-Néhémie, Esther) sont analysés comme une tentative de donner un sens aux épreuves du peuple, notamment l’exil à Babylone. Marks souligne que ces textes, bien qu’ils se présentent comme des chroniques, relèvent souvent de la fiction ou du mythe, visant avant tout à forger une identité collective. Comme il le note, « l’histoire biblique est un mélange de chronique, de légende et de réflexion théologique » (p. 103), plus révélatrice de l’époque où elle fut écrite que des événements qu’elle prétend raconter.
Les écrits poétiques et sapientiaux (Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques) sont abordés sous l’angle de l’expérience individuelle, explorant des thèmes universels : la souffrance, la quête de sens, la piété et l’amour. Marks met en lumière leur diversité tonale, du désespoir de Job à la sensualité du Cantique des Cantiques, en passant par le scepticisme résigné de l’Ecclésiaste. Enfin, les prophètes sont dépeints comme des figures subversives, à la fois porte-parole de Dieu et critiques acerbes des institutions religieuses de leur temps.
Thèses de l’auteur
L’une des thèses centrales de Marks est que la Bible est un texte « provocateur », qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Il refuse d’y voir un simple manuel de morale ou de dogme, préférant y découvrir un « guide pour ceux qui osent s’aventurer hors des sentiers battus ». Pour lui, les contradictions et les zones d’ombre de la Bible ne sont pas des faiblesses, mais des traits essentiels de sa richesse. « La Bible, écrit-il, est un texte qui exige d’être compris dans un dialogue sans fin » (p. 30).
S’appuyant sur les avancées de la critique moderne, Marks éclaire la genèse de ces textes, tout en évitant de les réduire à leur contexte historique. Il montre comment les rédacteurs bibliques ont travaillé par superpositions, combinant traditions anciennes et réinterprétations, chaque livre portant la trace de ces strates successives. Il insiste sur le caractère dialogique de la Bible, où les voix se répondent, se contredisent et s’enrichissent mutuellement.
Un autre atout de l’ouvrage est son attention aux dimensions littéraires et stylistiques des textes. Marks dissèque les procédés narratifs, les jeux de mots, les ironies et les parallélismes qui structurent la Bible, en faisant une œuvre à la fois poétique et philosophique. Il rappelle que « la littérature, comme l’a souligné Maurice Blanchot, naît du moment où elle devient question » (p. 9), et que la Bible, dès ses premiers versets, nous confronte à des « énigmes insolubles ».
Enfin, Marks s’attarde sur la figure de Dieu dans la Bible, à la fois proche et radicalement autre. YHWH n’y apparaît pas comme une entité abstraite, mais comme un personnage complexe, animé de passions humaines (colère, jalousie, compassion), dont la présence dans le texte est à la fois tangible et insaisissable. Cette tension entre familiarité et mystère est, selon lui, au cœur du « drame divin » qui traverse les récits bibliques.
Un regard critique
Marks adopte une lecture « ouverte » de la Bible, qui peut dérouter ceux qui recherchent une interprétation plus traditionnelle. Certains regretteront peut-être qu’il n’accorde pas plus de place aux commentaires rabbiniques ou patristiques, qui ont aussi marqué l’histoire de ces textes.
En couvrant l’ensemble de l’Ancien Testament, l’auteur est parfois contraint de survoler certains livres ou thèmes, laissant le lecteur avec l’envie d’approfondir.
Bien que l’ouvrage soit accessible, il suppose une certaine connaissance des textes bibliques et des débats exégétiques. Les débutants pourraient trouver certaines analyses trop techniques.
Ainsi,
Ouvertures bibliques est un livre exigeant, mais captivant, qui renouvelle notre regard sur l’Ancien Testament. Herbert Marks y parvient à rendre vivante une tradition souvent perçue comme lointaine ou figée, montrant comment la Bible continue de nous parler, de nous questionner et de nous émerveiller. Son approche, à la fois savante et littéraire, en fait un outil précieux pour quiconque s’intéresse à ces textes, qu’il soit croyant, sceptique ou simplement curieux.
Au fond, cet ouvrage est une invitation à aborder la Bible non comme un recueil de certitudes, mais comme un miroir de nos propres interrogations – une proposition aussi stimulante qu’incontournable. Comme le suggère Marks, la Bible est un texte qui « se dérobe aux interprétations trop faciles », mais qui récompense ceux qui acceptent de s’y plonger avec curiosité et humilité. Une lecture qui, sans aucun doute, laisse des traces.