
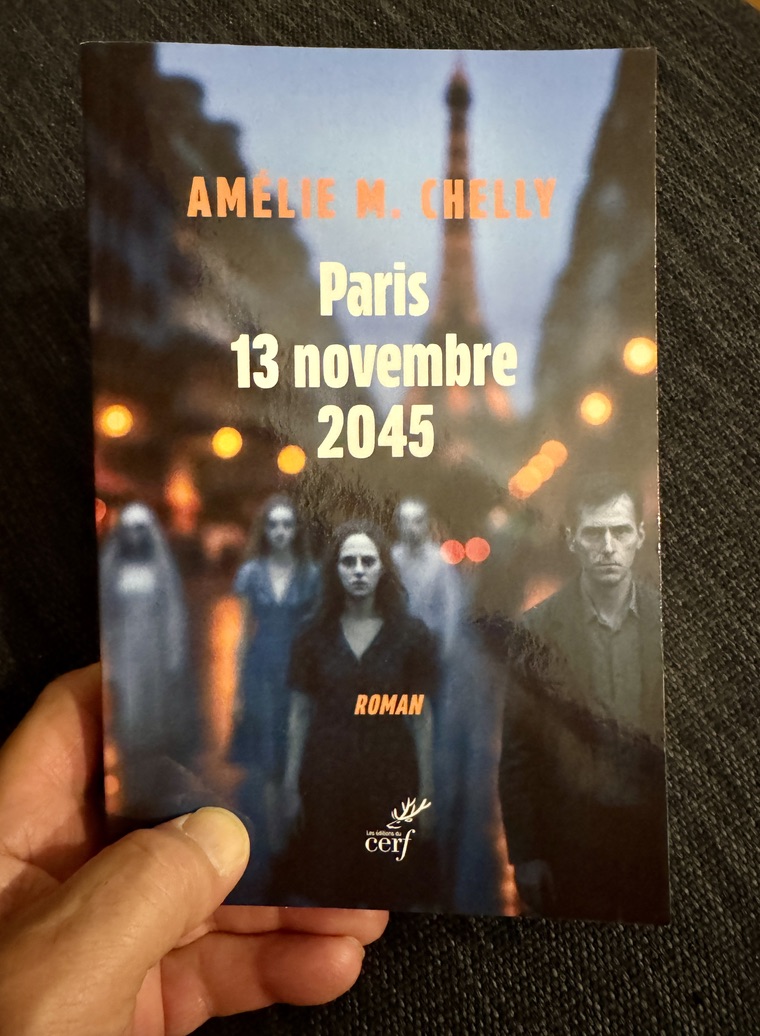
Plonger dans 13 octobre 2045, c’est un peu comme déambuler dans un Paris à la fois reconnaissable et étrangement déformé, un univers où le passé et le futur s’entremêlent pour composer une fresque à la fois fascinante et glaçante. L’auteur, dont on ne connaît pas vraiment l’identité, y dessine une Europe en pleine mutation, où les repères traditionnels ont volé en éclats. Le Faubourg Saint-Antoine, jadis symbole de vitalité artisanale et commerciale, se transforme en décor d’une société en crise, où les boutiques de prêt-à-porter ont laissé place à des trafics obscurs et où les cafés d’antan ont été remplacés par des établissements sous surveillance idéologique. Les personnages qui peuplent ce quartier emblématique — Iris, fragile et rêveuse ; Clara, comptable méthodique et rigide ; Ange, antiquaire exubérante ; Vincent, observateur discret ; Mira, globe-trotteuse insaisissable ; et Diane, écrivain intransigeante — incarnent chacun à leur manière les tensions d’une époque où l’individualisme se heurte à une quête désespérée de sens.
Ce qui frappe dès les premières lignes, c’est la manière dont le roman capture l’essence d’un monde en pleine décomposition. Les grandes enseignes ont disparu, remplacées par une économie de la récupération et des réseaux parallèles plus ou moins légaux. Les mouvements radicaux, comme #MeatToo, imposent leurs normes, tandis que les technologies numériques, à travers les fameuses « bulles communautaires », enferment les individus dans des réalités sur mesure, étouffant toute forme de débat authentique. Iris, avec sa phrase « La vie a toujours été pour moi un fardeau, autant qu’il soit de belle étoffe » (p. 20), résume à elle seule cette époque où l’on fuit la réalité en la parant d’illusions.
Les thèmes abordés résonnent avec une actualité brûlante : la montée des extrémismes, la manipulation des mémoires collectives, la marchandisation des émotions et la place de l’art dans une société dominée par l’intelligence artificielle. Le roman pose des questions cruciales : que reste-t-il de l’humanité quand 80 % des livres sont générés par des algorithmes ? Quand les références culturelles se banalisent au point de voir le rap côtoyer Descartes dans les programmes scolaires ? Diane, qui persiste à écrire à la main dans un monde où tout est automatisé, devient le symbole d’une résistance désespérée contre la déshumanisation.
L’écriture, à la fois élégante et percutante, alterne entre des descriptions poétiques et des dialogues acérés. Les scènes des soirées d’Iris à Cabourg, où les invités dansent en costumes du XIXe siècle, contrastent violemment avec les moments de tension urbaine ou les échanges politiques cinglants. Les références à Brahms, Liszt ou Mahler ajoutent une profondeur culturelle qui enrichit le récit sans jamais le rendre pesant. Pourtant, certains passages, notamment ceux qui traitent des trafics d’armes ou des théories conspirationnistes, peuvent sembler un peu trop explicites, comme si l’auteur avait peur que le lecteur ne saisisse pas pleinement les enjeux sous-jacents.
Si le roman séduit par son ambition et sa pertinence, il n’est pas exempt de défauts. Les personnages, bien que bien campés, frôlent parfois la caricature : Clara et son obsession du contrôle, Mira et ses transformations incessantes, ou encore les antagonistes, souvent réduits à des figures unidimensionnelles de méchants sans nuance. La fin, tragique et prévisible, laisse également une impression d’inachèvement, comme si l’auteur avait privilégié la démonstration idéologique à une véritable exploration psychologique.
Malgré ces réserves, 13 octobre 2045 reste une lecture captivante, un roman qui ose affronter les peurs et les contradictions de notre époque. Il rappelle, avec une force rare, que la littérature peut encore servir de miroir à nos angoisses et de rempart contre l’indifférence. Comme le soulignait récemment Georges Didi-Huberman dans Les Anges de l’Histoire, nous vivons des temps troublés — et ce livre en est une illustration saisissante.