
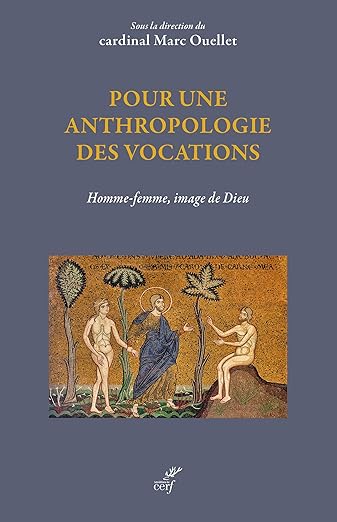
Le titre de l’ouvrage peut être trompeur dans sa présentation. Il ne s’agit pas des vocations religieuses (2 articles seulement) mais de la vocation de chaque humain à devenir ce qu’il est, en séparant bien ce qui est de la femme et ce qui est de l’homme. La vocation est entendue comme la réalisation dans chaque humain de l’image de Dieu (p 196) en reprenant Genèse 1, lu comme une clef de la spécificité et la complémentarité de chaque sexe (p 201). Pour les collaborateurs de l’ouvrage, il y a une crise anthropologique qui se manifeste par la confusion des genres et l’exclusion de Dieu dans la compréhension de l’humain.
Le livre est un recueil des conférences données à Rome en 2024 par différents auteurs plutôt thomistes qui cherchent à bien fonder la différence entre homme et femme et à dénoncer la confusion des genres et l’antispécisme. Sur ce dernier aspect – la différence entre les humains et les animaux- la conférence de SF Gaine op est particulièrement complète et donne beaucoup d’informations sur une littérature peu connue.
Différentes conceptions de ce qu’est un humain se retrouvent dans l’ouvrage. Un premier axe cherche à prendre en compte la fragilité constitutive de l’humain et son expérience de la souffrance comme étant universelle ; l’anthropologie doit partir de là. Un autre axe exploré est celui de la parole : la vocation n’est pas seulement un appel mais aussi une réponse. La voix est ainsi le propre de l’humain (p 62). Un autre axe est exploré : celui de la communion et de la mission qui sont le propre de l’humain (p 231) et qui articulent la liberté et la relation (p 213). L’approche dominante est cependant celle d’un projet de Dieu qui donne sa dimension plénière à chacun, à l’image du Christ, image de l’humain parfait (p 223) et le rend capable d’une rencontre avec le Christ, manifestation de sa possible perfection et de sa vocation spécifique (p 226). Reprenant une expression de K. Wojtyla, R Guerra Lopez écrit dans sa synthèse du colloque «l’être humain est vocation : ce que je suis et ce que je suis appelé à être »
Comme dans tous colloques, certains textes sont plus intéressants que d’autres. Outre celui de Gaine déjà cité, celui de A. Frigerio sur la sexualité humaine doit être lu et discuté. Avec la notion de fluidité des sexes et des identités, l’auteur veut démontrer que le système (capitalisme et infosphère, p 113) a transformé l’humain, l’a dénaturalisé pour en faire un produit culturel. Ce travail de sape identitaire – l’idéologie du gender- efface les différences alors qu’elles sont structurantes de l’humanisation. La différence sexuelle n’est ni purement biologique, ni purement culturelle, elle combine la nature et la culture (p 308) et doit être maintenue.
Le fil rouge de ces interventions était l’image de Dieu présente en chaque humain. Cet imago est décliné de plusieurs manières, la plus explicite étant l’orientation fondamentale de l’homme vers Dieu (p. 312) qui reprend Lumen Gentium. Là réside le mystère de la filiation qui donne la dignité de la personne humaine, son épanouissement homme et femme de manière différenciée. C. Granados situe cet imago dans trois dimensions : parler, travailler et procréer (p 202-204) et insiste sur la forme nuptiale de celui-ci qui est vocation à l’amour à partir du Cantique des cantiques et de la lettre aux Ephésiens. F. Daguet (op) souligne avec justesse la nécessité d’une prise en compte communautaire de cet imago Dei (p 233).
Les deux articles sur la vie religieuse affirment que cette forme de vie chrétienne est à l’image de l’amour du Christ et sont un témoignage vocationnel.
Le recours à St Thomas ou à Urs Von Balthasar est toujours fructueux mais ce colloque ne donne pas véritablement leur place aux approches non occidentales, aux réflexions contemporaines des sciences humaines et aux apports d’autres théologies ou d’autres philosophies. L’aspect de plaidoyer pour la différenciation des sexes est certes justifié mais son systématisme fragilise la thèse.
Ce recueil comprend une brève homélie de cdl Robert Prevost avant d’être Léon XIV.