
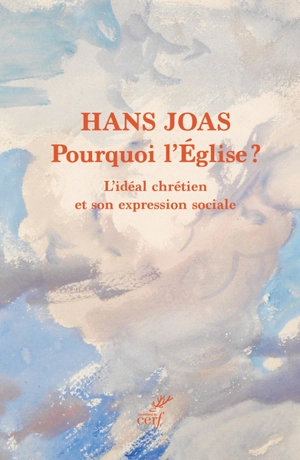
Hans Joas,
Pourquoi l'Église ? - Une défense sociologique de l'institution religieuse
Editions du Cerf, 2025, 255 p.
Hans Joas, sociologue et philosophe allemand reconnu pour ses travaux sur la théorie sociale et la sociologie religieuse, livre avec Pourquoi l'Église ? un recueil d'essais qui aborde frontalement l'une des questions les plus pressantes du christianisme contemporain. Loin d'être une monographie systématique, l'ouvrage rassemble onze textes qui « abordent le thème selon différentes perspectives plutôt que le traiter en progressant pas à pas » (Introduction).
Un projet intellectuel ambitieux
Le livre s'inscrit dans un projet plus vaste que Joas développe depuis longtemps : « proposer une alternative historique et systématique à ce qu'on appelle 'la théorie de la sécularisation' » (Introduction). Cette théorie, qui postule que « la modernisation économique, technique et scientifique conduit nécessairement à un affaiblissement de toute forme de religion » (Introduction), se trouve remise en question par l'auteur au profit d'un « récit alternatif » consistant en « une histoire globale de l'universalisme moral ».
Cette approche permet à Joas de replacer le christianisme « dans une lumière qui permet aussi de jeter un nouveau regard sur l'Église » (Introduction), dépassant ainsi les grands récits historiques influents portant sur « une histoire universelle du désenchantement (comme chez Max Weber) ou sur l'histoire universelle interprétée comme une autoconnaissance progressive de la raison divine (comme chez Hegel) ou de la raison séculière (comme chez Habermas) » (Introduction).
La question de l'institutionnalisation religieuse
Le cœur de l'argumentation de Joas réside dans une interrogation fondamentale : pourquoi les premiers chrétiens ont-ils éprouvé le besoin de créer une institution spécifique ? Comme l'explique l'auteur, « il ne s'agit pas de justifier une institution parce qu'elle remplirait un but ou s'avérerait 'fonctionnelle' pour un 'système' déterminé, mais de réfléchir aux causes qui, jadis, poussèrent ceux qui croyaient en Jésus-Christ à donner naissance et à rendre vivante une institution qui se démarque de toutes les formes sociales existantes » (Introduction).
Cette question devient particulièrement urgente dans un contexte où « beaucoup de contemporains trouvent en effet que l'ethos chrétien de l'amour du prochain est plausible, au moins en son noyau, et que les formes chrétiennes de spiritualité sont attractives » tout en se demandant « pourquoi l'on ne pourrait pas être chrétien sans appartenir à une Église » (Introduction).
Les expériences d'autotranscendance
Un des apports les plus originaux de l'ouvrage concerne l'analyse des « expériences d'autotranscendance ». Joas développe l'idée que la religion n'est pas réductible à une simple « faiblesse », contrairement à l'interprétation de Brecht face à la conversion de Döblin (chapitre 4). Pour les croyants, explique-t-il, « ils ne peuvent pas vivre sans l'expérience consistant à pouvoir apporter toute jubilation, tout souci et même tout doute, et d'avoir ainsi part à une aide » (chapitre 4).
L'auteur insiste particulièrement sur « l'accès à une sphère d'expériences dans lesquelles les individus peuvent dépasser les frontières de leur soi, par exemple en participant à la liturgie et en pénétrant dans des 'espaces sacrés' » (Introduction). Cette dimension experientialleHERE constitue selon lui un élément irréductible de la vie religieuse.
Critique du rôle politique des Églises
Une partie substantielle de l'ouvrage est consacrée à une critique du positionnement politique des Églises allemandes, particulièrement visible dans les chapitres 10 et 11. Joas s'interroge sur la tendance des Églises à devenir des « agences de morale », critiquant notamment « la justification inconditionnelle d'une politique d'immigration libérale par les deux grandes Églises d'Allemagne » (Introduction).
Sa critique ne vise pas « en général le rôle politique des Églises », mais formule « des réserves face à l'univocité avec laquelle on argumentait au nom du christianisme dans ce seul champ politique » (Introduction). Il pointe un problème de cohérence : « pourquoi tirer, sans guère de médiations, des conséquences politiques de l'ethos de l'Évangile dans le champ de la politique migratoire et pas dans d'autres domaines comme la paix ou le désarmement ? » (Introduction).
L'universalisme moral et la dignité humaine
Les chapitres 8 et 9 développent une réflexion approfondie sur « l'idée d'une dignité humaine universelle, une dignité identique pour tous les êtres humains, une dignité qu'ils n'ont pas acquise et qu'ils ne peuvent pas perdre » (Introduction). Joas s'interroge sur le statut de cet idéal : constitue-t-il « le noyau d'une nouvelle religion - par-delà toutes les religions constituées - ou si cet idéal ne peut et ne saurait exister qu'en lien avec des configurations à chaque fois spécifiques, et donc particulières » (Introduction) ?
Une analyse critique
L'ouvrage présente plusieurs qualités remarquables. La richesse de l'érudition de Joas, qui mobilise aussi bien la sociologie classique que l'histoire des idées, impressionne. Ses analyses de figures comme Alfred Döblin (chapitre 6) ou Leszek Kolakowski (chapitre 7) apportent un éclairage original sur les rapports complexes entre intellectuels et christianisme au XXe siècle.
La critique des « pronostics problématiques » sur la sécularisation (chapitre 3) s'avère particulièrement pertinente. Joas montre avec finesse comment « au lieu d'une lutte politique à visage découvert contre l'État absolutiste, on faisait régulièrement intervenir une philosophie de l'histoire prétendant montrer que cette forme d'État était obsolète » (chapitre 3), mécanisme qui se reproduit dans les débats contemporains sur la religion.
Cependant, l'ouvrage présente aussi certaines limites. Le caractère de recueil d'essais, bien qu'assumé par l'auteur, nuit parfois à la cohérence d'ensemble. Certains développements, notamment sur les cas américain et chinois (Introduction), restent superficiels et auraient mérité un approfondissement.
Plus fondamentalement, si Joas critique avec justesse le caractère prédictif de la théorie de la sécularisation, sa propre alternative théorique reste parfois floue. La notion d'« universalisme moral » aurait gagné à être conceptualisée de manière plus rigoureuse.
Conclusion
Pourquoi l'Église ? constitue néanmoins une contribution stimulante aux débats contemporains sur l'avenir du christianisme institutionnel. En refusant aussi bien l'optimisme libéral que le pessimisme conservateur, Joas ouvre une voie médiane qui mérite l'attention. Son plaidoyer pour une Église qui ne soit « ni une simple agence de morale, fût-ce au nom d'une morale universaliste » (Introduction) ni une institution repliée sur elle-même, dessine les contours d'une ecclésiologie renouvelée, attentive à la fois aux défis contemporains et à la spécificité du message chrétien.
L'ouvrage s'adresse autant aux sociologues de la religion qu'aux théologiens et aux acteurs ecclésiaux soucieux de repenser le rôle de l'institution religieuse dans nos sociétés plurielles. Il confirme la position de Hans Joas comme l'un des penseurs les plus subtils des rapports entre modernité et religion.